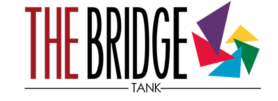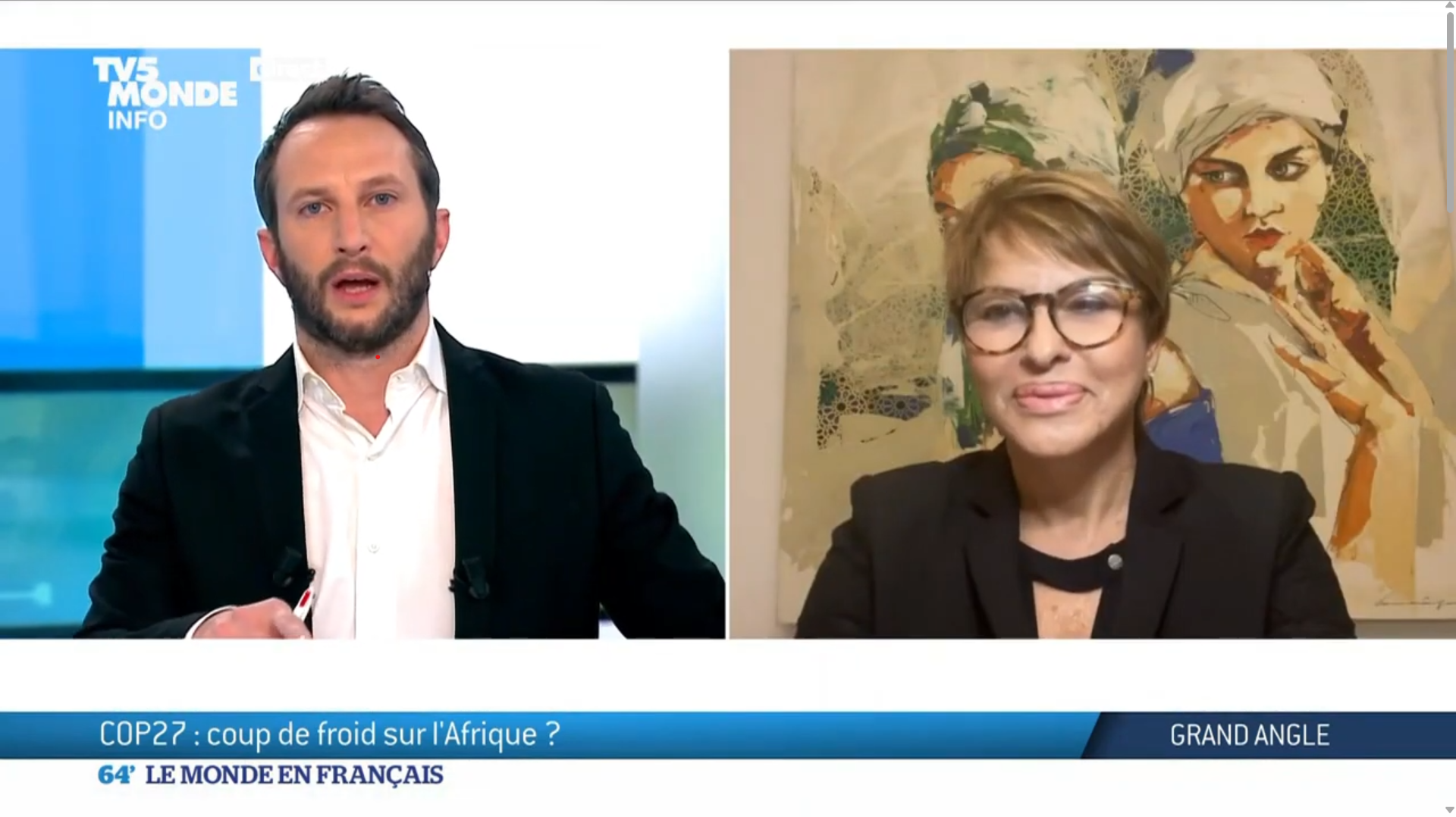Contribuer à la paix dans un contexte de tensions croissantes – Une co-production The Bridge Tank & CGTN Dialogue
Durant le Forum de Paris pour la Paix en novembre dernier, The Bridge Tank a été coproducteur invité d’une édition spéciale de Dialogue, l’émission de débats phare de CGTN. L’émission était dédiée au thème de la paix et la coopération internationale dans un contexte de tensions grandissantes au niveau mondial, dans la continuité du thème du Forum de cette année: « Construire ensemble dans un monde de rivalité. » L’émission s’est penchée sur la nature et les causes de la rivalité, les défis à relever en matière de paix et les pistes possibles d’une collaboration à long terme.
Diffusée depuis Paris, l’émission a été animée par Xu Qinduo, présentateur de Dialogue, et Joel Ruet, président de The Bridge Tank, et a accueilli un panel varié d’experts du monde diplomatique, d’organisations de la société civile et de l’industrie pour traiter de ces sujets :
- Stéphane Gompertz, ancien Ambassadeur en Autriche & en Éthiopie ; board member de The Bridge Tank,
- Blessing Ibomo, Fondatrice de Bread’s Earth,
- Jérémie Ni, Directeur de Chinform.
Revoir l’émission (en anglais)
Les questions abordées durant l’émission
Comment se traduit la rivalité dans le monde d’aujourd’hui ?
Quels sont les terrains d’entente possibles sur le changement climatique, la cybersécurité ainsi que les conflits en Ukraine, à Gaza, l’instabilité chronique dans certaines parties de l’Afrique, les crises humanitaires et la rivalité entre grandes puissances ?
Avec ces crises en cours, la politique d’endiguement technologique menée par les États-Unis à l’égard de la Chine, les tensions entre l’UE et la Chine, comment l’UE et la Chine peuvent-elles trouver des intérêts communs et développer leur coopération bilatérale ?
La coopération technologique entre l’UE et la Chine peut-elle être renforcée sans investissements, après le déraillement de l’accord d’investissement ? Les investissements sont-ils possibles sans la confiance ? Cette confiance peut-elle exister dans un monde en crise ?
Les crises récentes ont vu les Nations Unies de plus en plus divisées dans leurs votes et résolutions, avec des réponses particulièrement mitigées de la part du Sud. Comment analysez-vous le prétendu fossé entre le Sud et l’Occident ?
La Chine a récemment remporté un succès diplomatique au Moyen-Orient, en contribuant au rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Dans le même temps, l’Inde a annoncé un nouveau corridor économique reliant l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe lors du G20. Quel rôle pouvons-nous prévoir pour les grandes puissances émergentes dans l’ordre diplomatique mondial ?
Quelques citations de nos invités
Sur la rivalité
« Je pense qu’aujourd’hui, les rivalités et les désaccords semblent éclipser les défis communs auxquels nous sommes tous confrontés : des défis à long terme comme le changement climatique, le terrorisme, les pandémies parfois. Et nous avons tendance à oublier qu’au-delà de tous les différends que nous pouvons avoir entre nos pays respectifs, nous sommes confrontés aux mêmes défis pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Ces défis vont bien au-delà de nos désaccords actuels. »
Stéphane Gompertz, ancien Ambassadeur en Autriche & en Éthiopie ; board member de The Bridge Tank,

Sur le rôle des puissances émergentes
« Ces puissances émergentes vont jouer un rôle de plus en plus important. En effet, elles peuvent contribuer à améliorer les relations internationales et à résoudre les crises. […] Elles ont une grande influence et il est clair qu’il devrait y avoir plus de coopération entre toutes les puissances, les grands ou les petits pays du monde pour aider à faire avancer les choses. […] La tendance est à l’accroissement du rôle de ces pays émergents dans les affaires mondiales. À condition évidemment que les relations restent amicales, positives et pacifiques, ce rôle peut s’avérer très utile.Cela dépend évidemment de la manière dont chaque pays mène sa propre politique.
Lorsque nous voyons l’agression insensée de la Russie contre l’Ukraine, nous espérons que l’influence actuelle de la Russie ne sera pas trop grande.
Lorsque la crise sera terminée, les choses seront différentes. Nous avons besoin de la Russie, la Russie est un grand pays, nous avons toujours eu de bonnes relations avec elle. Ce qu’ils font en ce moment est absolument insensé et nous espérons que cela ne durera pas trop longtemps. Nous parlons beaucoup de multipolarisation, d’un monde multipolaire qui peut en effet être très utile. Le monde ne devrait pas être dominé par un seul pays, mais par une coopération entre tous les pays. »
Stéphane Gompertz, ancien Ambassadeur en Autriche & en Éthiopie ; board member de The Bridge Tank,

Faire entendre la voix de l’Afrique
« Je pense que l’une des erreurs que nous commettons est de classer l’Afrique comme une seule nation. L’Afrique compte 54 pays aux intérêts nationaux différents. Nous ne pouvons pas avoir une seule voix pour représenter l’Afrique, c’est impossible. L’Ukraine, par exemple, est la corbeille à pain dont dépendent la plupart des pays africains en termes de céréales et de pain. Je pense que les Nations unies doivent donner aux pays africains, et pas seulement à l’Union africaine, la possibilité d’exprimer leur voix et d’entendre ce qu’ils ont à dire, car les pays ont des intérêts économiques différents en tête, ainsi que des intérêts politiques et historiques qu’ils doivent prendre en compte. Il s’agit d’une relation complexe qui doit être prise en compte dans les divers pays africains. »
Blessing Ibomo, Fondatrice, Bread’s Earth
Sur la coopération technologique
« La Chine étant désormais le principal acteur mondial dans le domaine des batteries, avec 6 des 10 plus grands fabricants de batteries provenant de Chine, c’est un bon moyen pour l’Europe et la France, avec Stellantis et Renault, de travailler avec les Chinois, d’apprendre de la Chine. Et la Chine peut aussi apprendre des Européens. Par exemple, dans l’industrie automobile, la société française STMicroelectronics est le leader en matière de puces utilisées dans les voitures. Les Chinois peuvent apprendre d’eux. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons grandir ensemble. »
Jérémie Ni, Directeur de Chinform.


Sur la confiance et la dépendance
« Le mot confiance est très important. Les difficultés que nous rencontrons actuellement s’expliquent par un manque de confiance et de reconnaissance mutuelle des règles du jeu. Un élément qui peut y contribuer, du moins du côté européen, est la peur de la dépendance. Il y a un problème avec les minéraux et terres rares. Par exemple, les Pays-Bas ont décidé de mettre leur veto à l’exportation de semi-conducteurs vers la Chine, qui a riposté en interdisant l’exportation de germanium et de gallium vers l’ensemble de l’UE. Voilà le genre de mesures et de contre-mesures qui peuvent être préjudiciables. Si nous pouvions éliminer cette peur de la dépendance, en encourageant également d’autres sources afin d’équilibrer nos importations, nos exportations et l’utilisation des minéraux, peut-être que cette confiance pourrait apparaître. Mais les règles du jeu devraient être plus claires de part et d’autre ».
Stéphane Gompertz


Replay des autres interventions de The Bridge Tank dans Dialogue sur CGTN :