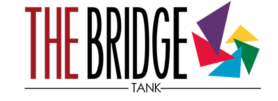Démographie galopante, chômage massif, nécessité de valoriser les économies africaines, autant d’enjeux qui invitent à l’entrepreneuriat et à développer les savoir-faire de la population, chez les jeunes en particulier… Aïssa Dione oppose les besoins et les opportunités concrètes et propose la notion de « soft industry ».
Démographie galopante, chômage massif, nécessité de valoriser les économies africaines, autant d’enjeux qui invitent à l’entrepreneuriat et à développer les savoir-faire de la population, chez les jeunes en particulier.
Face aux (trop ?) grands débats sur le développement et les aides financières à débloquer, Aïssa Dione oppose les besoins et les opportunités concrètes et propose la notion de « soft industry », ou industrie fondée sur les compétences réelles des populations et la formation technique.
Conversation directe avec une industrielle ancrée dans le réel et au franc parler.
J.R. : Aissa Dione, vous êtes designer, galeriste, véritable industrielle du textile avec deux sites de production et femme d’influence reconnue par Frobes Africa. Que faut-il penser aujourd’hui de la réalité de l’industrie en Afrique ?
A.D. : On parle toujours d’infrastructures, mais les gens font une espèce d’omerta sur la mise en œuvre d’industries. Nos gouvernants se sont calés sur de méga-industries en pensant qu’ils allaient rentrer en compétition avec le reste du monde, alors qu’ils auraient très bien pu développer un nouveau type d’industrie qu’on appelle la soft industry. La Soft-industrie s’appuie sur ce que les gens maîtrisent, et peut pénétrer le marché international tout en occupant le marché local. Il suffirait pourtant d’un peu de matériel et de très peu d’investissements.
J’ai créé ma petite menuiserie au Sénégal. Mais il n’y a pas de formation en menuiserie, il n’y a pas d’école, il n’y a rien. Et que voit-on ? Une multitude d’importations de mobiliers de Chine, d’Inde, d’Italie, de France… Il m’a fallu 15 000 euros pour monter une petite menuiserie. On dépense je ne sais combien de milliards dans les routes. Donnez-moi l’équivalent financier de 10 km de route, et je relance une industrie au Sénégal.
J.R : Donc la Soft Industry existe déjà. C’est simplement une question d’accompagnement ?
A.D : Oui. Les Italiens ont commencé comme cela, avec de petites entreprises familiales. Aujourd’hui, les grands groupes s’appuient sur les petites entreprises familiales. Ce modèle aurait pu se développer dans nos pays et aurait été beaucoup plus adapté. Mais aujourd’hui, on ne sait produire ni clous, ni aiguilles, ni bougies, et on vous parle tout le temps d’infrastructures énormes ! Les « politiques de développement » sont incapables de favoriser la mise en place de petites unités de production. La notion de production en Afrique n’est pas encore là. Aujourd’hui, on la met en œuvre au niveau de l’agro-business peut-être. Ça commence dans le secteur tertiaire également. Mais il faudrait aussi se pencher sur le secteur secondaire et sur les « métiers ».
J.R. : Quand vous parlez de soft industry en Afrique et d’accompagnement autour des savoir-faire, quelle est la réaction des politiques en général ?
A.D. : Le problème c’est que les politiques ne connaissent pas et ne maîtrisent pas les métiers d’art ou les formations techniques. Ils ont toujours eu comme modèle l’administration française, les écoles littéraires, les universités ou encore les études de médecine. Mais ils n’ont jamais eu accès à une école d’ébénisterie. Pour eux, il est acquis que toutes ces choses sont importées. Ils n’y pensent même pas.
J.R. : Alors sans attendre les gouvernements – même si on comprend qu’il y aurait idéalement besoin d’un peu d’accompagnement -, aujourd’hui les entrepreneurs peuvent aller de l’avant. Peut-on nous dresser un panorama des secteurs dynamiques en Afrique de l’Ouest où l’on observe les prémisses de cette soft industry ?
A.D. : Il n’y a pas grand-chose en réalité. L’industrie textile a capoté car elle a voulu aller sur le mass production. Dans le bois, on voit quelques menuiseries se monter. Mais comme il n’y a pas de formation adéquate, ça tâtonne. Tout l’argent investi dans l’éducation aurait plutôt dû l’être dans la formation professionnelle. Aujourd’hui, il n’y a même pas 10% de formations techniques dans notre pays alors que nous disposons de matières premières.
J.R. : Beaucoup de gens pensent que l’Afrique, l’Afrique de l’Ouest en particulier, peut s’industrialiser grâce à la Chine…
A.D. : C’est un grand mot, industrialiser. Il y a plusieurs niveaux d’industrialisation. L’industrialisation pour moi, dans un premier temps, c’est le développement d’unités manufacturières. Vouloir caler tout le monde sur les mêmes dimensions de l’industrie ne me semble pas pertinent. Nous sommes 14 millions au Sénégal. En Chine, ils sont 1,4 milliard environ.
Les mass productions sont adaptées à des populations d’1,4 milliard. Au Sénégal, on peut développer le pays en produisant pour des marchés de niche et en plus petite quantité. Si la notion de qualité pouvait prévaloir au moins de temps en temps sur la notion de quantité, cela pourrait aider je pense.
F.C. : Vous parliez d’opportunité en matière de transformation de matière première…
A.D. : En Afrique de l’Ouest, vous avez plus d’un million de tonnes de coton, de fibre, qui sont produites et zéro mètre de tissus. C’est tout de même absurde. Tout cela parce qu’on ne fait pas de recherche et développement. On se contente de vouloir copier tout ce qui se fait ailleurs. On ne mise pas sur nos compétences nationales.
F.C : D’où viendront les nouveaux élans, si les gouvernements et les Etats sont incapables de remarquer cela ?
A.D. : Les gouvernements s’intéressent peu à peu au sujet. Au Sénégal notamment, où on parle pourtant de développer une politique de mise en place du mobilier national.
Nos pays construisent à tout va pour loger une population de plus en plus dense. Cette politique pourrait donc créer des nouveaux marchés, celui du mobilier ou celui de l’aménagement intérieur, tandis qu’aujourd’hui on passe notre temps à tout importer. Pour changer la donne, il faut faire de petites écoles de soudure de fer, de tapisserie de meubles, d’ébénisterie, etc.
J.R. : Le Sénégal a mis en place un ministère en charge de l’artisanat et de la formation.
A.D. : Oui. Mais le mot artisanat est très dévalorisé. Je n’utilise plus ce mot, j’utilise ceux de savoir-faire et d’activités manufacturières. L’artisanat, on le cantonne ; il s’exerce souvent sous forme d’association, de coopérative ou à titre individuel, entités qui souvent ne payent pas d’impôts, et ne permettent souvent pas de développer le marché, de s’engager à l’export, d’entrer dans l’économie de marché finalement. Pour moi, l’idée est donc de fédérer les savoir-faire et les activités manufacturières, pour créer une force qui puisse pénétrer l’économie de marché. Certains font de la mass industry et d’autres de l’industrie créative. Le marché est assez grand pour que les deux co-existent.
J.R. : C’est frappant car malgré la multiplication, de débats et de mesures prises en Afrique de l’ouest en matière d’agriculture intégrée ou de formation par exemple, il semble en effet que sur les autres matières, le bois, le cuir, y compris celles qui viennent du sol, comme le coton, l’enjeu de la transformation est beaucoup moins mis en avant…
A.D. : C’est carrément la razzia sur les bois. Quelques pays réagissent. Je pense au Gabon qui a interdit l’exportation de grumes, je pense à la Côte d’Ivoire, et même le Sénégal commence à s’y mettre.
Quant au coton, c’est invraisemblable. Le cercle vicieux est très simple : le coton part vers la Chine, le Vietnam ou ailleurs ; il est transformé sur place, vendu en occident, et les déchets nous reviennent. Je m’explique : Si tu donnes tes vieux vêtements à Emmaüs qui les emmène en Afrique, tu tues l’industrie ! Cette charité éternelle, ces aides, font qu’on ne peut pas se développer.
F.C. : Il faut donc arrêter d’être charitable avec l’Afrique ?
A.D : Absolument. Beaucoup de théoriciens africains parlent de cela.
F.C. : Et il faut l’aider comment ?
A.D. : Il ne faut pas l’aider ! Pourquoi l’aider ? Il faut être partenaires à armes égales.
E.L. : Aucune aide ? Je partage avec vous l’idée que les dons déstabilisent les filières, mais des aides ne sont-elles pas envisageables ponctuellement pour répondre à une situation de crise ?
A.D. : Ecoutez. L’Europe est passée par des situations de crise et s’en est sortie. En Afrique, on passe de situation de crise en situation de crise, il va donc falloir gérer la situation de crise à un moment donné et s’en relever.
E.L. : Pourquoi, malgré les immenses opportunités de transformation de matières premières, si peu d’entreprises se structurent pour effectivement transformer ces matières premières.
A.D. : Car le Sénégal a adopté le modèle de l’administration française. On a fait du copier-coller sur des systèmes européens qui ne sont pas du tout adaptés à des pays où, aujourd’hui, il y a 90% de chômeurs. On nous met le même code du travail qu’en France et la même TVA ! En tant que producteur, je veux transformer, je veux produire, je veux vendre sur le marché national, et je ne peux pas car j’ai une TVA de 18% bêtabloquante pour n’importe quelle personne qui veut se formaliser pour créer une entreprise.
J.R. : Je vais jouer l’avocat du diable. Finalement ce dont manquerait l’Afrique de l’Ouest, ce serait-ce pas des entrepreneurs ? Je pose la question à une entrepreneure !
A.D. : Il y a des entrepreneurs, mais ils ont énormément de difficultés. Ils ne sont jamais financés. Les banques ne te financent pas, donc quand tu fais quelque chose c’est sans elles ou presque. En 20 ans, j’ai seulement eu 150 000 euros de prêts de la banque. Voilà pourquoi ça me fait rire quand on dit qu’on emmène des milliards pour le développement. Nous, entrepreneurs, n’avons rien vu de tout cela.